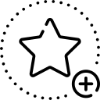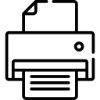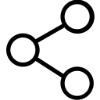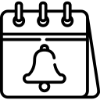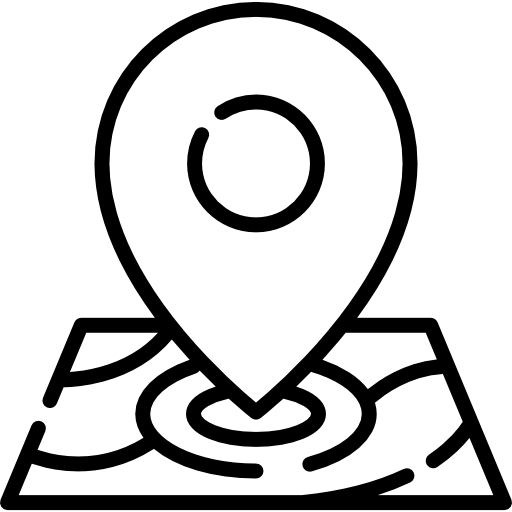Éditorial
Politique de la Ville : "pour une histoire du temps présent des villes"
Remi Cambau
"Faire cette histoire pourrait permettre de parler des fractures", estime ce 5 juillet le comité d'histoire de la politique de la Ville en France, voulu par Nadia Hai, ministre déléguée à la Ville dans le gouvernement Castex. Le comité devrait accompagner la démarche scientifique d'une "histoire du temps présent" de la politique de la ville. Une journée d'études au Campus Condorcet ce 5 juillet a commencé à poser les bases d'un travail pluridisciplinaire tourné vers les habitants et leur histoire, tout autant que vers celle des différentes périodes de l'action publique, l'évaluation devant nourrir la décision politique. Déjà, la politique de la ville, cet "objet de malentendus permanents", selon Philippe Estèbe, directeur d'études à Acadie, devrait trouver dans la démarche une solution à son énigme : elle se prolonge et s'élargit depuis quarante ans, alors que le constat de son échec semble partagé...
"Nombreux sont les constats désabusés devant la récurrence de la séquence violence policière / émeute ou révolte / répression / plan pour les banlieues", analyse Philippe Estèbe directeur d'études à Acadie Coopérative. Pour lui, faire l'histoire de la politique de la ville, c'est montrer notamment les transformations profondes de la population des quartiers prioritaires, et faire le récit de ces évolutions pour sortir des "photos figées". "Cette histoire est aussi une histoire de la violence. Violence illégale, légale, violence de la société ou des individus et des groupes," Pour Philippe Estèbe, faire l'histoire de la politique de la ville pourrait permettre la discussion des fractures, qui paraît récurrente dans le débat public, et qui autorise toutes les simplifications, condamnations, anathèmes. Le travail du comité s'apparenterait à un travail de médiation auprès d'un large public.
"Non, la politique de la ville ne saurait être réduite à une uni-causalité, selon laquelle elle servirait à contenir les émeutes urbaines, ni à une mono-thématique : la rénovation urbaine". D'emblée, la première intervention de Thibault Tellier, professeur à Sciences Po Rennes, lors de la première journée d'études du Comité d'histoire de la Politique de la Ville (voir le site), avait mis en perspective les réactions et commentaires qui foisonnent depuis la mort du jeune Nahel mardi 27 juin à Nanterre.
Car la Politique de la Ville se réduit en effet souvent à la rénovation urbaine, comme si l'urbanisme était responsable d'un mal avant tout social et historiquement provoqué notamment par la désindustrialisation. "Faire démarrer la politique de la ville en 1981 (DSQ) ou même en 1977 (Habitat et Vie Sociale) est certes juste, mais pas suffisant." Thibault Tellier estime qu'il faut la replacer dans "la longue histoire de la réforme urbaine" depuis le développement de la ville industrielle - il relève notamment la place constante jouée par la Caisse des Dépôts et Consignations, depuis la production des HBM. "Par exemple on pourrait la relier au programme de 1928 sur la fin des lotissements défectueux (loi Sarraut) et sur la mise en œuvre de la loi du ministre de la prévoyance sociale Louis Loucheur qui consiste à permettre à des catégories modestes d’accéder à des logements neufs et modernes".
Une histoire de la ville industrielle des Trente Glorieuses
Car, s'il est vrai que le "mal des grands ensembles" ressenti par les habitants des ZUP, a conduit dès les années 70 à réinterroger les dogmes du Mouvement Moderne, le "choc" principal déstabilisateur de ces grande unités urbaines est rappelé par Gwenaëlle Le Goullon, de l'Université Lyon 3 : "L'histoire de la politique de la ville est liée à l'histoire industrielle et donc sa crise est aussi liée à la désindustrialisation. Dans le périmètre de ce qui devait devenir la Courly, on compte 730 000 habitants en 1946, mais 1,2 million en 2006. De fait, on a construit 400 000 logements très vite, et surtout des grands ensembles, pour accompagner des installations industrielles massives notamment à Vénissieux. A ce moment-là, un tiers des travailleurs logés à La Duchère travaillaient à la Rhodiacéta..." [devenue Rhône-Poulenc Textile" NDLR]. Avec la désindustrialisation massive des années 80-90, rappelle la chercheuse, "on a remplacé des milliers d'emplois ouvriers par quelques centaines d'emplois industriels et des emplois tertiaires non destinés au même public".
Brigitte Guigou, directrice à l'agence d'urbanisme Institut Paris Région, qui travailla longtemps sur ces questions, confirme qu'en Île-de-France aussi, toute la Seine-Saint-Denis a vu construire de grands ensembles en lien avec l'industrialisation massive de ce territoire, pour en loger les ouvriers. De même qu'en Seine Aval, Mantes-la-Jolie, Chanteloup, voient des cités s'édifier pour la main-d'œuvre de l'industrie automobile. Alors, la politique de la ville pourrait-elle être analysée comme "une tentative pour désamorcer la question sociale" ?
Une histoire sociale, et du face à face avec la puissance publique
Faire l'histoire de la politique de la ville c'est entrer dans une histoire sociale, à l'évidence, et apporter des clés de lecture de la situation actuelle et des pistes de solutions, qui dépassent les seules bonnes intentions d'une politique marquée à ses débuts par le catholicisme social, rappelle Christine Lelévrier (Paris Est Créteil), pour qui le souci de "rendre service" est toujours présent, même chez ses étudiants.
Mais qui dit histoire sociale dit identification des acteurs collectifs de cette histoire, et donc quelles catégories définir ?, s'est interrogé le comité. Celle des "jeunes" par exemple, demande une intervenante, que signifie-t-elle ? et dans quelle mesure est-elle pertinente sur un plan historique ? et celle de "post colonial" ou de "racisé", etc. ?
De fait, souligne Philippe Estèbe, la politique de la ville s'intéresse au couple Etat, dans ses différents niveaux, d'intervention publique nationale et locale, ses acteurs sociaux, bailleurs et travailleurs sociaux, face aux forces vives qui composent la société urbaine, les habitants de ces quartiers populaires. De fait, souligne-t-il, la chance d'une histoire de la politique de la ville, est de pouvoir s'appuyer sur des matériaux vivants, des témoins, des acteurs. Comment ne pourrait-elle pas aider à tracer des voies pour l'avenir ?
Une politique jugée "en échec" mais toujours prolongée et amplifiée
"La politique de la ville est l'objet de malentendus permanents", ajoute le directeur d'études. "Ce n'est pas tout-à-fait une politique urbaine, pas tout-à-fait une politique ciblant les banlieues, pas tout-à-fait une politique destinée aux étrangers, aux immigrés, aux "minorités visibles", ni tout-à-fait une politique sociale. C'est l'énigme d'une politique mobilisant pendant quarante ans décisions, mesures, dispositifs, actions, et des sommes loin d'être marginales, placée en marge du droit commun, et pourtant pointée du doigt pour ses échecs."
"Il faut contester le concept de "politique de LA ville", estime pour sa part Sylvie Harburger qui fut secrétaire générale de la commission nationale pour le développement social des quartiers de 1986 à 1988. "Il y a DES politiques et DES villes, et c'est aussi un problème. L'émiettement communal qui traduit les limites des politiques de la ville, des villes. L'échelle des problèmes par rapport à l'échelle des communes est cruciale, d'où l'intérêt de se pencher sur LES histoires locales."
Des perspectives ont été ouvertes ce 5 juillet 2023, qui mettent en évidence la complexité d'un sujet qui embrasse toutes les dimensions de la vie en société et de ses milieux urbains. En même temps, les membres du comité d'histoire sont armés, à titre personnel, de leur propres expérience de ces réalités, et se sont placés, en commençant, sous l'égide d'un Antoine Prost qui militait, dès 1999, dans la revue Vingtième Siècle, sur le thème "Villes en crise" pour que s'impose l'urgence d'une histoire "du temps présent des villes". Sous de telles auspices, le comité créé en 2022 par arrêté de Nadia Hai pourrait éviter l'écueil de produire une histoire administrative, pour répondre au besoin actuel, pas moins brûlant qu'au tournant du 21e siècle, celui d'une "histoire du temps présent". Le comité d'histoire devrait en accompagner la démarche scientifique.
Rémi Cambau
NOTE. La Journée d'études du 5 juillet 2023 était organisée sur le thème : "Faire l’histoire de la politique de la ville. Enjeux, sources et méthodes".
avec :
- Michel Didier, Président du Comité d’histoire de la politique de la ville
- Marie-Christine Jaillet, vice-présidente du Comité d’histoire de la politique de la ville (Université Toulouse Jean-Jaurès)
- Emmanuel Bellanger (Centre d’histoire sociale des mondes contemporains, Université de Paris I)
- Approches historiographiques
- L’histoire de la politique de la ville dans la longue durée : Thibault Tellier (Sciences Po Rennes)
- Retour sur le programme d’histoire et d’évaluation des villes nouvelles. Quels enseignements ? : Loic Vadelorge (Université Gustave Eiffel)
- Un cas régional d’études : Rhône-Alpes : Gwenaëlle Le Goullon (Université Lyon 3)
- Croisements disciplinaires : A quoi et à qui peut servir de faire l’histoire de la politique de la ville ?
- Renaud Epstein (Sciences Po Saint-Germain)
- Philippe Estèbe (Coopérative Acadie)
- Christine Lelévrier (Université Paris Est Créteil
Le comité d'histoire de la politique de la ville organise à la mi-octobre son premier séminaire sur le thème "La jeunesse et la ville".

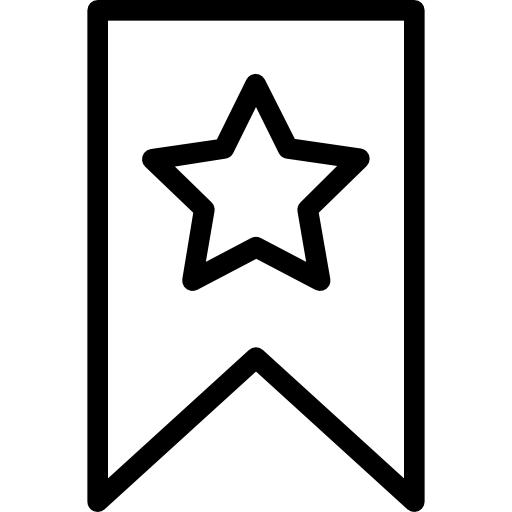 Favoris
Favoris 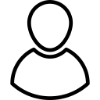 Se connecter
Se connecter 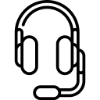 Contact
Contact